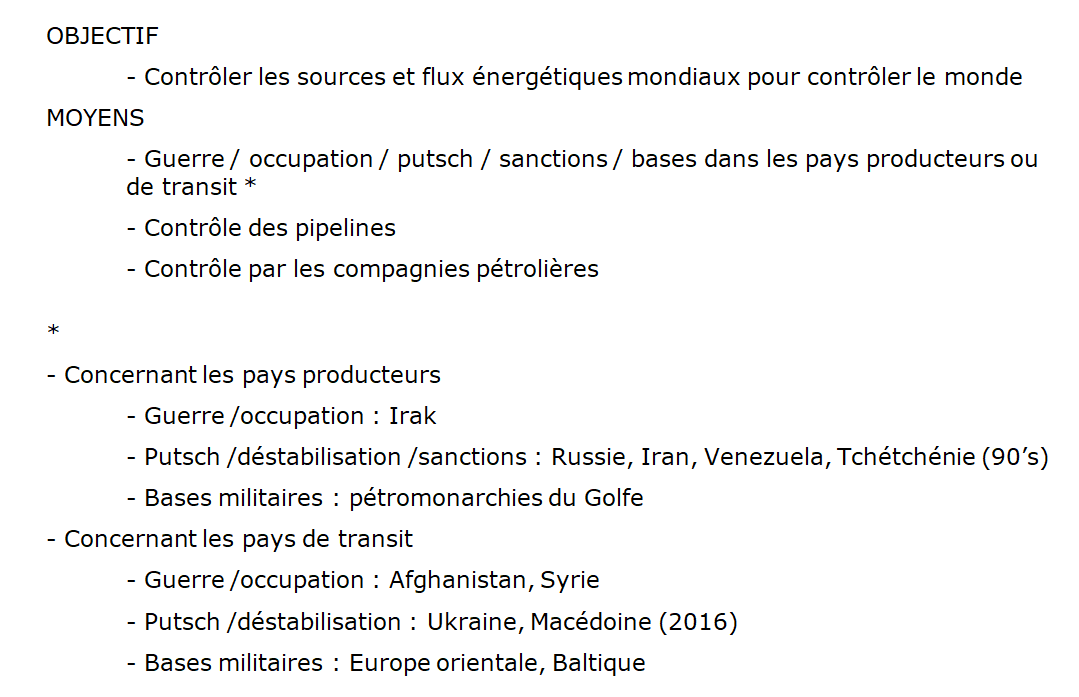Kamala Harris a récemment qualifié l’Iran de «
force déstabilisatrice et dangereuse » au Moyen-Orient. Si on veut
comprendre cette remarque, il faut se pencher sur le contexte puisque
cela s’inscrit dans l’histoire des dernières décennies au cours
desquelles les États-Unis ont cherché à déstabiliser l’Iran.

- Le Chah Mohammad Reza Pahlavi et Jimmy Carter lors d’une cérémonie
de bienvenue à la Maison Blanche, Washington, le 15 novembre 1977. (Diana Walker / Getty Images)
Depuis douze mois, depuis octobre dernier, les dirigeants américains
se félicitent des bombardements incessants d’Israël sur Gaza, alors même
que le génocide qui s’y déroule – financé et armé par les États-Unis – a
tué plus de quarante mille Palestiniens, dont près de la moitié sont
des femmes et des enfants. Les manifestations de satisfaction se sont
poursuivies alors qu’Israël a étendu ses bombardements à trois autres
pays arabes : le Liban, le Yémen et la Syrie.
Encore insatisfaits, certains encouragent maintenant Israël à
bombarder l’Iran. Joe Biden aurait « discuté » de la perspective d’une
attaque israélienne contre les champs pétrolifères iraniens, lesquels
constituent la base de l’économie iranienne et qui s’étiolent en raison
de l’embargo américain dévastateur qui dure depuis des décennies.
À la suite du tir de missiles iraniens sur Israël la semaine
dernière, effectué en représailles à l’assassinat par Israël de
dirigeants du Hamas et du Hezbollah, la Vice-présidente et candidate
démocrate à l’élection présidentielle Kamala Harris a qualifié l’Iran de
« force déstabilisatrice et dangereuse » au Moyen-Orient, ouvrant ainsi
un nouveau chapitre dans la longue histoire belliciste américaine à
l’encontre de l’Iran. Lundi dernier, elle est allée encore plus loin en
qualifiant l’Iran de « plus grand adversaire » des États-Unis.
Une longue histoire violente
Ceux qui connaissent l’histoire de l’Iran ont du mal à entendre de
telles déclarations sans se remémorer le réveillon du Nouvel An 1977, un
an avant que la révolution iranienne n’éclate. Alors que les émeutes se
multipliaient en Iran, le président américain Jimmy Carter assistait à
un somptueux dîner d’État en compagnie du chah d’Iran, Mohammad Reza
Pahlavi, il a alors porté un toast : « Grâce à l’excellent leadership du
chah, l’Iran est un îlot de stabilité au coeur d’une des régions les
plus troublées du monde. »
Il est paradoxal de noter que ces discours avaient été précédés par
un long passé de déstabilisation de l’Iran par les États-Uni, une
histoire entachée d’opérations secrètes et d’interventions clandestines.
Vingt-quatre ans plus tôt, lors de l’Opération Ajax, la CIA, en
collaboration avec le MI6 britannique, avait orchestré un coup d’État
qui avait chassé le Premier ministre iranien démocratiquement élu, ce
dernier avait remporté la victoire en prônant la nationalisation du
pétrole iranien et en le soustrayant au contrôle de l’Occident. Ce coup
d’État a entraîné la désintégration de la démocratie naissante du pays
et devait hanter les Iraniens pour des décennies.
À partir de la fin des années 1940, dans le feu de la Guerre froide,
l’administration de Harry Truman a fait du jeune chah un partenaire
important de l’alliance antisoviétique naissante au Moyen-Orient, malgré
le ressentiment croissant des Iraniens à l’égard de la corruption du
chah et de la façon inconsidérée dont il vendait des ressources de
l’Iran à des sociétés étrangères pour financer son train de vie
somptueux. La folie dépensière du chah l’a conduit à vendre les droits
exclusifs sur le pétrole et le gaz naturel iraniens à des
multinationales pétrolières occidentales, principalement l’Anglo-Iranian
Oil Company (AIOC), qui ont exploité les Iraniens et exporté des
millions de barils de pétrole, générant des profits faramineux tout en
ne payant pratiquement rien à l’Iran.
Le ressentiment à l’égard du chah a rapidement donné lieu à une
contestation populaire. En octobre 1949, Mossadegh, critique de longue
date de la dynastie Pahlavi et ardent défenseur du droit de l’Iran à
contrôler sa propre industrie pétrolière, a fondé le Front national, une
large coalition comprenant à la fois des modérés de la classe moyenne
et des membres du parti de gauche Tudeh. Mossadegh et ses alliés ont
rapidement exercé le pouvoir au sein du parlement iranien, le Majles, où
ils se sont présenté en prônant le partage des profits pétroliers entre
l’Iran et l’AIOC, citant l’exemple d’autres multinationales pétrolières
opérant au Venezuela et en Arabie saoudite.
Le coup d’État contre Mohammed Mossadegh a entraîné la désagrégation
de la démocratie naissante du pays et devait hanter les Iraniens pour
des décennies.
Soutenue par le gouvernement britannique, l’AIOC a refusé tout
compromis. Le Majles a réagi en nationalisant l’industrie pétrolière
iranienne. Peu après, Mossadegh a été élu Premier ministre et a
immédiatement annoncé son intention de priver le Royaume-Uni du contrôle
des champs pétrolifères et des raffineries iraniennes.
L’Occident n’a pas tardé à prendre des mesures de rétorsion. Lorsque
Mossadegh a décidé la nationalisation, les gouvernements britannique et
américain ont uni leurs forces pour pousser le chah à destituer son
nouveau Premier ministre, menaçant le pétrole iranien d’un embargo
international, tout en préparant secrètement un coup d’État à Téhéran.
Le président Dwight D. Eisenhower a donné sa bénédiction à ce projet.
Du côté américain, les organisateurs du coup d’État étaient le
secrétaire d’État chargé des Affaires étrangères John Foster Dulles, un
anticommuniste enragé qui considérait Mossadegh comme un suppôt de la
Russie et un « cinglé », et Allen Dulles, le nouveau directeur de la
CIA, qui entretenait des liens étroits avec le MI6, agence de
renseignement britannique, et adorait les opérations secrètes visant les
nations qu’il jugeait susceptibles de faire l’objet d’une tentative de
subversion ou d’une prise de contrôle par l’Union soviétique. Pour
superviser le plan, Kermit Roosevelt, petit-fils de Theodore Roosevelt
et vétéran des opérations secrètes de la CIA, a été envoyé à Téhéran.
Des agents américains et britanniques ont mené ce qu’ils ont qualifié
de « contre-coup d’État » contre le gouvernement nouvellement élu, en
distribuant de généreux pots-de-vin pour mobiliser des centaines de
mercenaires pro-chah, qui ont déferlé dans les rues en scandant des
slogans anti-gouvernementaux et en déclenchant de violents affrontements
avec les partisans de Mossadegh. Pendant ce temps, le général Fazlollah
Zahedi, bien disposé envers l’Occident, et des officiers militaires de
droite, ainsi que la police secrète iranienne, connue sous le nom de
SAVAK, ont entrepris de rétablir l’ordre et de réprimer la dissidence,
en raflant les militants du parti Tudeh, en arrêtant Mossadegh et en
redonnant le pouvoir au chah.
Ce n’était qu’un début
Au nom de la lutte contre le communisme, les États-Unis ont contribué
à saboter une démocratie florissante au Moyen-Orient. Pour citer
l’historien américain Douglas Little : « Après s’être persuadés que
l’Iran était sur le point de basculer dans le communisme, Eisenhower et
les frères Dulles avaient encouragé les forces pro-américaines à
renverser un dirigeant iranien démocratiquement élu et à réinstaller sur
le trône du Paon un dirigeant de plus en plus autocratique. »
Le coup d’État de 1953, connu en Iran sous le nom de Coup d’état du
28 Mordad, était le prélude d’une longue histoire d’opérations secrètes
américaines destinées à changer des régimes et visant des dirigeants
démocratiquement élus dans l’ensemble des pays du Sud. Deux décennies
plus tard, au Chili, les États-Unis se sont rendus coupables d’un infâme
complot visant à renverser le président socialiste élu Salvador
Allende, contribuant ainsi à l’instauration d’une dictature autoritaire
de droite.
En Iran, e coup d’État de 1953 n’était qu’un début. Alors que le
ressentiment des Iraniens à l’égard du chah grandissait, les États-Unis
ont réagi en lançant une nouvelle opération secrète au début des années
1960. Peu après son investiture, John F. Kennedy a élaboré son propre
plan pour contrer l’agitation civile en Iran : une « révolution blanche
». En avril 1962, tout juste sorti de la débâcle de la Baie des Cochons,
il a invité le chah Pahlavi à Washington, et les deux dirigeants ont
envisagé un « plan de stabilité pour l’Iran ». Neuf mois plus tard, le
chah dévoilait sa Révolution blanche, un ensemble de réformes
modernisatrices « descendantes » destinées à éviter des changements
radicaux « ascendants », à l’instar de la révolution rouge de Fidel
Castro à Cuba. Au printemps 1963, des volontaires du Corps de la Paix
américain se sont rendus en Iran pour y promouvoir la modernisation
américaine et, alors que des centaines de sociétés américaines
commençaient à investir dans le « miracle économique » du chah, un flux
de millions de barils de pétrole quittait l’Iran à destination des
alliés de la Guerre froide des États-Unis en Asie et en Europe de
l’Ouest.
Pendant ce temps, les dirigeants de l’opposition iranienne, menés par
Ruhollah Khomeini, ridiculisaient le chah, le qualifiant de pantin des
américains et condamnaient les réformes soutenues par les États-Unis au
titre de l’« occitoxification » (Gharbzadegi en persan).
À la fin des années 1960, les responsables américains pensaient que
l’Iran appréciait la Révolution blanche du chah. La répression de la
dissidence par le chah les a réjouis, de même que sa décision d’exiler
Khomeini, qu’ils considéraient comme un « fauteur de troubles islamiques
gênant. »
En avril 1962, Kennedy, tout juste sorti de la débâcle de la Baie des
Cochons, a invité le chah Pahlavi à Washington, et les deux dirigeants
ont envisagé un « plan de stabilité pour l’Iran ».
Richard Nixon et Henry Kissinger sont alors entrés en scène.
Souhaitant à tout prix renforcer l’expansion des États-Unis au
Moyen-Orient et sortir du bourbier vietnamien, l’administration Nixon
considérait alors la monarchie Iranienne comme un supplétif des
États-Unis. En 1972, les deux hommes se sont rendus à Téhéran, où ils
ont présenté au chah leur « doctrine Nixon » : en échange de l’aide des
États-Unis pour assurer la stabilité politique en Iran, les États-Unis
autoriseraient le chah à acheter du matériel militaire non nucléaire
provenant de l’arsenal américain, notamment des hélicoptères de combat,
des avions de chasse et des frégates dotées de missiles guidés.
Le chah a adopté avec enthousiasme la nouvelle doctrine Nixon, se
lançant dans des achats somptuaires de matériel militaire américain à
hauteur de 13 milliards de dollars, financés par les revenus
supplémentaires générés par la montée en flèche des prix du pétrole à la
suite de la guerre israélo-arabe de 1973 et de l’embargo sur le pétrole
arabe. Mais le boom pétrolier n’a fait que semer la zizanie dans les
classes moyennes et populaires iraniennes, celles-ci considérant avec un
dégoût croissant les gaspillages du chah en matière d’armement
américain. Des émeutes ont éclaté dans les rues de l’Iran et ont été
réprimées brutalement par le chah, avec la bénédiction des États-Unis.
Depuis son exil en Irak, Khomeini, de plus en plus populaire, a
condamné l’effusion de sang et appelé au renversement du tyran soutenu
par les États-Unis. La révolution iranienne n’a pas tardé à voir le
jour.
Le 16 janvier 1979, le chah Pahlavi est monté à bord d’un Boeing 707 à
l’aéroport Mehrabad de Téhéran et a pris, après une brève escale en
Égypte, le chemin de l’exil aux États-Unis. Pour de nombreux Iraniens,
donner refuge au chah était un rappel amer de la conspiration de la CIA
pour renverser Mossadegh : les États-Unis, semblait-il, étaient un
superpuissant voyou qui récompensait les tyrans honnis et punissait les
dirigeants légitimement élus.
Après la révolution
Deux semaines après la fuite du chah, Khomeini est revenu en Iran
pour la première fois après quinze ans d’exil, promettant d’établir une
République islamique et de nettoyer le pays de toute influence qui
pourrait encore venir du « Grand Satan ». Khomeini et ses partisans ont
battu les forces de gauche qui avaient contribué à renverser le chah et
ont rapidement créé leur propre État autoritaire, qui a toutefois
bénéficié d’un soutien populaire en raison de son opposition à
l’impérialisme américain.
Pourtant, les États-Unis ont continué à se complaire dans le déni.
Les élites américaines ont rarement pris la peine de comprendre les
mouvements politiques islamistes ou la branche particulière du chiisme
de Khomeini. Elles n’ont jamais accepté de voir que les sentiments
anti-américains qui couvaient en Iran n’étaient pas d’origine religieuse
ou culturelle, ni le produit d’un « choc des civilisations » ou
d’autres absurdités anachroniques, mais qu’ils trouvaient leur origine
dans la longue histoire d’ingérence des États-Unis dans le pays et dans
leur soutien à la dictature du chah.
Les élites américaines n’ont jamais accepté de voir que les
sentiments anti-américains qui couvaient en Iran n’étaient pas d’origine
religieuse ou culturelle, mais qu’ils trouvaient leur origine dans la
longue histoire d’ingérence des États-Unis dans le pays.
Lorsque Ronald Reagan est entré en fonction en 1980, l’Iran était
plongé dans une guerre de plus en plus meurtrière contre l’Irak,
laquelle a duré huit ans et a fait un demi-million de morts, pour la
plupart des Iraniens. Désireuse de régler ses comptes avec l’Iran,
l’administration Reagan s’est rangée du côté de l’Irak, fournissant à
Saddam Hussein des armes et des avions, des renseignements militaires et
des milliards de dollars. Ce qui n’a pas empêché Reagan de conclure en
toute illégalité un accord « armes contre otages » avec le gouvernement
Khomeiny, dans le cadre du scandale connu sous le nom d’affaire
Iran-Contra..
La guerre Iran-Irak s’est terminée par un enlisement. Enhardi par son
partenariat avec les États-Unis, Saddam Hussein a envahi le Koweït
trois ans plus tard, et les États-Unis se sont rapidement retrouvés en
guerre contre leur ancien allié devenu un nouveau paria, l’Irak.
Enferrés dans l’hostilité
Depuis lors, la politique américaine à l’égard de l’Iran est entachée
des griefs du passé et s’est enfermée dans une hostilité anachronique.
Ne voulant pas se laisser distancer par ses prédécesseurs, Bill Clinton a
adopté une politique de « double endiguement », se traduisant par des
sanctions économiques invalidantes et des menaces militaires à titre
préventif pour affaiblir l’Iran, avec pour point d’orgue la signature de
la loi de 1996 sur les sanctions contre l’Iran et la Libye (Iran and
Libya Sanctions Act, ILSA).
Dans le même temps, les dirigeants iraniens tentaient de rétablir des
liens avec les États-Unis par une série de gestes de bonne volonté. En
mai 1997, le modéré et réformateur Mohammad Khatami a été élu président
et il a tendu un rameau d’olivier aux États-Unis, mais les iraniens se
sont heurtés à la très forte animosité et à la méfiance de
l’administration Clinton, celle-ci exigeant sans relâche que l’Iran
mette fin à son programme de recherche nucléaire, comme en témoigne la
loi sur la non-prolifération des armes nucléaires (Iran Nonproliferation
Act) de 2000.
Avec George W. Bush, les néoconservateurs ont officiellement fait de
la déstabilisation de l’Iran une vraie politique, là encore en dépit des
efforts déployés par l’Iran. Quelques heures après les événements du 11
Septembre, Khatami a adressé ses condoléances à Bush, tandis que des
milliers de jeunes Iraniens organisaient une veillée aux chandelles dans
les rues de Téhéran. Bush a réagi en qualifiant l’Iran de régime
terroriste et de membre de « l’Axe du Mal », aux côtés de l’Irak et de
la Corée du Nord. (Ou « Axe de la Malédiction », selon la toute dernière
formule de Benjamin Netanyahou, qui y inclut Gaza et le Liban).
Lorsque, quatorze mois plus tard, les troupes américaines ont envahi
l’Irak pour déposer Saddam Hussein, c’était au tour de Khatami de
condamner les États-Unis. Certains des principaux conseillers de Bush,
dont le vice-président Dick Cheney, se sont réjouis en privé de la
perspective d’une attaque préventive israélienne contre le complexe
nucléaire iranien de Bushehr, et ont même fomenté un complot pour
changer de régime à Téhéran. Peu satisfait de sa destruction aveugle de
l’Irak, Bush lui-même a donné au Pentagone l’ordre de planifier une
attaque contre les installations nucléaires iraniennes, ce dont l’ancien
président s’est vanté dans ses mémoires.
En faisant constamment le choix de la punition économique et en
cherchant des solutions militaires pour affaiblir le pays, les
États-Unis se sont toujours trompés sur l’Iran – qu’il s’agisse de la
CIA qui a renversé le Premier ministre démocratiquement élu Mossadegh,
de Carter qui a accueilli le chah autocrate, de Reagan qui a envoyé des
armes à l’Irak pendant la guerre Iran-Irak, de George W. Bush rejetant
un accord sur le nucléaire iranien, ou de Donald Trump sabotant l’accord
nucléaire de Barack Obama avec l’Iran et faisant assassiner Qassem
Soleimani, ou encore de l’administration Biden se montrant belliciste à
l’égard de l’Iran alors que les conflits régionaux se multiplient,
attisant les flammes d’une guerre plus vaste – sans compter l’envoi de
milliers de soldats américains de plus dans la région et l’obtention
d’un paquet d’aide militaire de 8,7 milliards de dollars pour Israël.
Depuis près d’un siècle, les États-Unis s’emploient à déstabiliser
l’Iran. Alors que la candidate démocrate à la présidence, une fois de
plus, multiplie les tirades contre l’Iran tout en soutenant le nouvel
assaut israélien contre le Liban, les responsables américains semblent
n’avoir tiré aucune leçon de l’histoire.
* Seraj Assi est un écrivain palestinien vivant à Washington, et
l’auteur, plus récemment, de My Life As An Alien (Tartarus Press).